30 mars 2013
6
30
/03
/mars
/2013
06:22
Que de belles promesses au générique de « LE PRIX DE LA PASSION » (ferons-nous un petit laïus sur l’inanité du titre français ? Non, il est piqué sur la tagline de l'affiche U.S.…) ! Déjà, le film est réalisé par Leonard ‘Spock’ Nimoy. Ensuite, on y trouve des stars de toutes générations : Teresa Wright et Ralph Bellamy en grands-parents, Diane Keaton égérie des seventies, Jason Robards le vétéran tous-terrains et enfin Liam Neeson tout jeune et fougueux.
et enfin Liam Neeson tout jeune et fougueux.
Évidemment, tout ceci est trop beau pour être vrai. Vraiment vrai, s’entend. Malgré cet alléchant générique, ce n’est qu’un pâle téléfilm pour grand écran, dont la première moitié est insupportable de mièvrerie bêlante et la seconde n’est qu’un ‘courtroom drama’ sans substance. Très mal dirigée Keaton minaude et use et abuse de ses vieux tics, mais comment pouvait-elle « vendre » un personnage aussi stupide, irresponsable et falot ? Même chose pour Neeson sorte de post-beatnik dont le scénario tente d’excuser le comportement soit carrément malsain, soit franchement débile. Étant donné qu’on ne ressent aucune empathie pour les protagonistes, et qu’on serait presque tenté de prendre parti pour le « méchant » ex-mari, l’ennui s’installe très rapidement et ne fait que se densifier. C'est platement filmé en plans moyens sans vigueur, la photo est léchée et « jolie », la musique excessivement irritante. Bref, on frôle le carton rouge.
L’amateur patient et stoïque trouvera une maigre consolation dans les scènes de Robards, impeccable en avocat intelligent et roué (il fallait qu’un personnage ait quelques neurones en état de fonctionnement), mais ce film laisse sur une sorte d’inexplicable énervement. Pourquoi diable nous a-t-on infligé l’histoire de ces gens-là ?
20 février 2013
3
20
/02
/février
/2013
06:31
« COMMENT L’ESPRIT VIENT AUX FEMMES » est un authentique et total délice ! À la base, c'est une variante de « PYGMALION », mais l’auteur en profite au passage pour parler de l’Amérique telle qu'il la rêve, des méfaits de l’ignorance, de démocratie et – pendant qu’on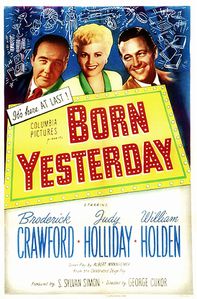 y est – de fascisme.
y est – de fascisme.
Tout un programme porté par un dialogue pétillant et constamment spirituel, des personnages parfaitement dessinés, des situations cocasses et même un chouïa émouvantes. Et enfin et surtout, joué par des acteurs au sommet de leur forme : Judy Holliday est unique en ‘dumb blonde’. Avec sa voix aiguë, sa vulgarité roborative, son sens du timing qui frise parfois le génie, cette petite touche de pathos qu'elle met toujours sous la comédie, elle crée un personnage formidable d’humanité, transcendant le symbolisme du texte. Face à elle, le toujours très classe William Holden, à l’ironie tranquille, joue son « professeur », un idéaliste à la Capra qui décèle la pureté et l’innocence sous la façade de « poule » abrutie et soumise. Et puis Broderick Crawford, qui campe un véritable aïeul de Tony Soprano, puisqu’il incarne un gangster du New Jersey propriétaire de sociétés de ramassages d’ordures et s’achetant des politiciens à Washington. Braillard, brutal, insensible, il compose un parfait salopard tout en parvenant à rester parfois drôle. La longue partie de gin rammy entre lui et Miss Holliday est inoubliable.

Élégamment écrit, idéalement rythmé, intégrant de jolis extérieurs dans un ensemble plutôt théâtral, « COMMENT L’ESPRIT VIENT AUX FEMMES » est un vrai remède contre le cafard.
15 février 2013
5
15
/02
/février
/2013
05:42
D’entrée, dès les premières images, « WE NEED TO TALK ABOUT KEVIN » met mal à l'aise. La confusion règne, les plans s’enchaînent, agressifs, énigmatiques, chargés de violence et de malheur. C'est l’introduction à un film construit de façon kaléidoscopique, qui traite d’un sujet rarement abordé au cinéma parce que franchement tabou : l’absence d’amour d’une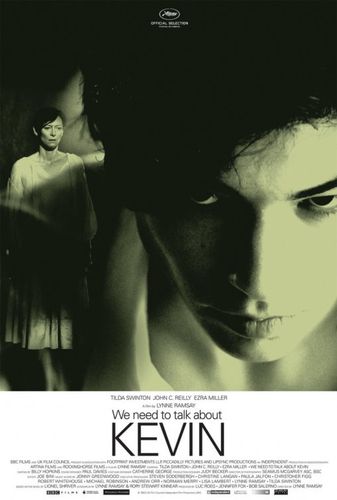 mère pour son propre enfant.
mère pour son propre enfant.
Dès la naissance, dès les premiers pleurs, Tilda Swinton n’éprouve rien pour son fils, à part une exaspération croissante, qui se transforme en répulsion, puis progressivement en haine réciproque. Le gamin lui, grandit dans cet environnement qui pourtant maintient les apparences, et se mue peu à peu en sociopathe dangereux. Jusqu'à l’horreur finale.
Entièrement centré sur ses deux personnages principaux, le film floute délibérément le reste. On ne sait pas vraiment ce que font les parents comme métier, on ne sait rien de leur famille, de leurs amis. Le décor, c'est la maison et le sujet, la fabrication silencieuse et inéluctable d’un monstre généré par le manque d’amour. Dire que le film est inconfortable est une douce litote. Il est carrément suffocant, d’autant qu'il est extrêmement bien joué par l’étrange Swinton et le jeune et glauque Ezra Miller. En père aveugle et inconscient, John C. Reilly est parfait, comme toujours.
Bien sûr, on pourra discuter de la pertinence de ce scénario qui rejette toute la responsabilité sur les épaules de la mère. ‘Kevin’ est un monstre parce que sa maman s’est montrée distante et a fait semblant de l’aimer. Est-ce suffisant pour devenir un ‘mass murderer’ ? Possible… N’y a-t-il pas des prédispositions ? Quoiqu’il en soit, ce film stylisé, esthétiquement soigné, froid et implacable, traite son sujet à fond, sans faux-fuyants et oblige à ses poser des questions très dérangeantes. Ce qui n’est déjà pas si mal…
13 février 2013
3
13
/02
/février
/2013
06:33
« COMMENT TUER SON BOSS ? » ne cherche même pas à masquer ses références, il les affiche fièrement. Il serait vain d’énumérer tous les films dont il s’inspire (même le titre français est calqué sur un autre titre français : « COMMENT SE DÉBARRASSER DE SON PATRON » !), mais le but est clairement de capitaliser sur le succès du récent « VERY BAD TRIP ». On prend trois crétins velléitaires, on leur donne des patrons odieux et on les lance dans une folle nuit en forme d’engrenage.
TRIP ». On prend trois crétins velléitaires, on leur donne des patrons odieux et on les lance dans une folle nuit en forme d’engrenage.
On aimerait rire plus et surtout que ce rire soit de meilleure qualité. Ce n’est pas le cas. Quand on se surprend à pouffer, c'est devant des gags éculés, des mimiques outrées, des situations graveleuses, des quiproquos poussifs. Nos trois losers n’étant pas d’une grande subtilité, on suit leurs mésaventures d’un œil détaché, d’autant que c'est extrêmement mal filmé et platement photographié.
Que reste-t-il, alors ? Quelques ‘guests’ qu’on est toujours content de revoir : Donald Sutherland qui disparaît avant même d’avoir commencé à apparaître, Jennifer Aniston déchaînée en nympho botoxée, Kevin Spacey qui ressert son numéro de « boss from Hell » de « SWIMMING WITH SHARKS » sans le moindre complexe ou Jamie Foxx très drôle en pseudo-voyou prénommé ‘Motherfucker’. Mais la palme revient très certainement à Colin Farrell, méconnaissable en dégénéré cocaïné amateur de kung-fu : ce qu'il y a de meilleur dans le film.
Il n’y a pas grand-chose d’autre à dire. Selon l’humeur du moment, on pourra être distrait par ce sous-produit opportuniste, dont la seule vraie qualité est une bonne humeur décomplexée et un évident manque de prétention.
4 février 2013
1
04
/02
/février
/2013
07:03
Une femme seule d’un certain âge qui pousse son amant dans les bras d’une jeune fille riche. Comment ne pas penser aux « LIAISONS DANGEREUSES », surtout quand l'homme est incarné par le même John Malkovich ? Tourné huit ans après le film de Frears, « PORTRAIT DE FEMME » est inspiré de l’œuvre d’Henry James, mais lorgne clairement vers le succès de son prédécesseur.
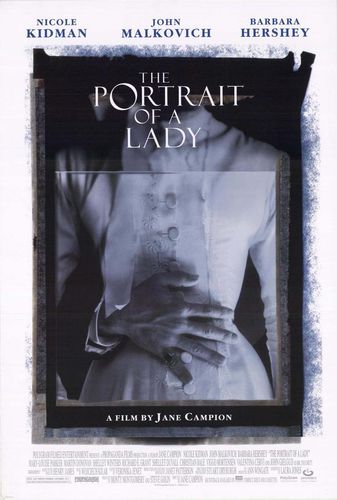 Cinéaste fétiche du festival de Cannes, Jane Campion – hormis le très beau « UN ANGE À MA TABLE » – est une réalisatrice surévaluée et systématiquement décevante. Son présent film est un pensum atrocement lent et froid, qui décrit l’enlisement d’une femme libre et aventureuse, qu’un mariage avec un escroc transforme en spectre tristounet. La photo est sombre et lassante pour l’œil, le rythme mortifère, les comédiens donnent l’impression de ne pas toujours savoir où ils vont et évoluent en pilotage automatique. Nicole Kidman en particulier, dont les états d’âme sont exprimés par un immuable visage lisse et impassible, est une protagoniste ennuyeuse et peu attachante. Ces 140 minutes en sa compagnie sont une véritable épreuve d’endurance. Pourtant le casting est majestueux, mais Campion en fait peu de cas : on peut sourire de voir les jeunes Viggo Mortensen avec sa minivague frisottée, en soupirant éconduit, Christian Bale en jouvenceau fébrile. Mais Barbara Hershey joue les sous-Merteuil sans éclat, Malkovich plus maniéré que jamais, est difficilement supportable et les vieux de la vieille que sont Shelley Winters ou John Gielgud ne font que passer. Seul s’en sort à peu près Martin Donovan en cousin tuberculeux.
Cinéaste fétiche du festival de Cannes, Jane Campion – hormis le très beau « UN ANGE À MA TABLE » – est une réalisatrice surévaluée et systématiquement décevante. Son présent film est un pensum atrocement lent et froid, qui décrit l’enlisement d’une femme libre et aventureuse, qu’un mariage avec un escroc transforme en spectre tristounet. La photo est sombre et lassante pour l’œil, le rythme mortifère, les comédiens donnent l’impression de ne pas toujours savoir où ils vont et évoluent en pilotage automatique. Nicole Kidman en particulier, dont les états d’âme sont exprimés par un immuable visage lisse et impassible, est une protagoniste ennuyeuse et peu attachante. Ces 140 minutes en sa compagnie sont une véritable épreuve d’endurance. Pourtant le casting est majestueux, mais Campion en fait peu de cas : on peut sourire de voir les jeunes Viggo Mortensen avec sa minivague frisottée, en soupirant éconduit, Christian Bale en jouvenceau fébrile. Mais Barbara Hershey joue les sous-Merteuil sans éclat, Malkovich plus maniéré que jamais, est difficilement supportable et les vieux de la vieille que sont Shelley Winters ou John Gielgud ne font que passer. Seul s’en sort à peu près Martin Donovan en cousin tuberculeux.
Malgré toute la bonne volonté du monde, « WWW » ne trouve guère de qualité rédemptrice à ce monument d’ennui et de prétention, qui laisse l’impression que les seuls moments potentiellement intéressants du scénario ont disparu entre les cartons indiquant régulièrement à l’écran « 3 ANS PLUS TARD… » ou autres.
6 janvier 2013
7
06
/01
/janvier
/2013
08:46
Et si Shakespeare n’était qu’un cabotin de seconde zone illettré ? S’il avait usurpé l’œuvre d’un noble dans l’incapacité de signer ses œuvres ? Si l'homme toujours adulé aujourd'hui, joué sans arrêt, filmé encore et encore, analysé jusqu'au vertige, n’avait jamais réellement existé ? C'est la thèse défendue par « ANONYMOUS », dont la première surprise et de trouver la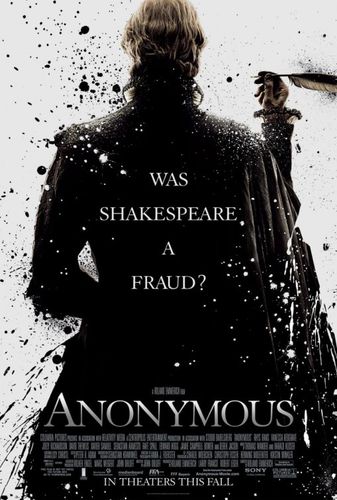 signature du belliqueux Roland Emmerich à la mise en scène.
signature du belliqueux Roland Emmerich à la mise en scène.
Le scénario pour convaincant et parfois brillant qu'il soit, s’emballe trop souvent et se perd dans une construction en flash-backs qui finit par être soûlante. Quand apparaît sur l’écran « 5 ANS PLUS TÔT » puis « 40 ANS PLUS TÔT », cela fait plutôt naître l’agacement que l’intérêt. Il faut s’accrocher pendant le premier tiers : surabondance de noms, de personnages, de fausses barbes et de maquillages vieillissants, on a du mal à identifier les protagonistes, d’autant que le montage est ultra-cut et la photo très sombre.
Reste que, si on a passé ce cap difficile, « ANONYMOUS » n’est pas dénué de qualités. Au niveau de l’interprétation déjà, on a droit à une fabuleuse Vanessa Redgrave dans le rôle de la reine, une vieille femme au bord de la sénilité, mais encore capable de cruauté. C'est une fois de plus sa fille Joely Richardson qui tient le même rôle dans les flash-backs, avec un réalisme parfait. Citons aussi Rhys Ifans, douloureux et énigmatique, dans le rôle du véritable auteur des pièces signées Shakespeare.
Film sombre, iconoclaste, n’hésitant jamais à tirer sur les vieilles ficelles du mélodrame, « ANONYMOUS » finit in extremis par réussir son pari. Il est fort probable qu’on ne lise plus jamais le nom du grand « Will » de la même façon, après la projection.
19 décembre 2012
3
19
/12
/décembre
/2012
08:47
 Certains sujets sont vraiment dans l’air du temps et ce n’est certainement pas par hasard que « GRAFFITI PARTY » (arrrrgghhh ! Ces titres français !!!) présente autant de similitudes scénaristiques avec « VOYAGE AU BOUT DE L’ENFER » sorti la même année.
Certains sujets sont vraiment dans l’air du temps et ce n’est certainement pas par hasard que « GRAFFITI PARTY » (arrrrgghhh ! Ces titres français !!!) présente autant de similitudes scénaristiques avec « VOYAGE AU BOUT DE L’ENFER » sorti la même année.
Le film de Cimino est un chef-d’œuvre unanimement célébré, celui de John Milius situé dans un tout autre milieu, est plutôt devenu un ‘cult-movie’ et essentiellement aux U.S.A. où la « culture surf » est ancrée depuis longtemps.
On y parle donc d’une bande d’amis – surtout un trio de champions locaux, de la jeunesse qui s’achève, de la guerre du Vietnam qui menace de faucher ces garçons insouciants, obsédés par les grosses vagues et les bitures. Mais la comparaison avec le Cimino s'arrête là. « GRAFFITI PARTY » n’en a ni la puissance, ni la densité dramatique, ni le casting.
obsédés par les grosses vagues et les bitures. Mais la comparaison avec le Cimino s'arrête là. « GRAFFITI PARTY » n’en a ni la puissance, ni la densité dramatique, ni le casting.
C'est un film qui progresse par touches, au rythme alangui de la vie en bord de mer. On y suit des fêtes où l’alcool coule à flots, où les bagarres éclatent pour un rien, où les filles tombent enceintes. Ce n’est guère passionnant et on sent que Milius fait son possible pour rendre tout cela « mythique », comme de nombreux films l’ont fait pour le baseball. Mais il est difficile d’être fasciné par ces gentils crétins bronzés et peroxydés aux muscles saillants, par leur « mentor » barbu qui fabrique leurs surfs et bâtit leur légende. À vrai dire, tout cela semble forcé et un chouïa ridicule. D’autant que les images de surf sont beaucoup trop rares pour générer une quelconque admiration, même à la fin lors du fameux ‘Big Wednesday’ où les doublures sont beaucoup trop visibles.
Jan-Michael Vincent est très bien dans ce rôle de surdoué de la planche autodestructeur, mais comme ses partenaires, manque d’étoffe et de finesse.
À noter l’hommage-clin d’œil à Sam Peckinpah dans la séquence finale, lorsque les trois amis marchent côte à côte vers la mer déchaînée, fendant la foule, qui est une reproduction fidèle de la célèbre traversée de la ville des derniers membres de « LA HORDE SAUVAGE ».
16 décembre 2012
7
16
/12
/décembre
/2012
16:59
 Lana Turner était considérée comme la reine du ‘tearjerker’ (les films qui font pleurer) et malgré un talent de comédienne très limité, elle a fait une jolie carrière dans cet emploi.
Lana Turner était considérée comme la reine du ‘tearjerker’ (les films qui font pleurer) et malgré un talent de comédienne très limité, elle a fait une jolie carrière dans cet emploi.  « LA MOUSSON » ne fait pas exception dans sa filmo, même s’il se déroule en Inde. D’abord, elle n’y a probablement jamais mis les pieds, car les extérieurs sont visiblement l’œuvre d’une seconde équipe et le reste a été tourné en studio à Hollywood et ensuite, elle n’a jamais été plus larmoyante, mécanique et pénible qu’ici. Impossible de déceler la moindre étincelle de sentiment ou d’émotion sous sa mise-en-plis peroxydée.
« LA MOUSSON » ne fait pas exception dans sa filmo, même s’il se déroule en Inde. D’abord, elle n’y a probablement jamais mis les pieds, car les extérieurs sont visiblement l’œuvre d’une seconde équipe et le reste a été tourné en studio à Hollywood et ensuite, elle n’a jamais été plus larmoyante, mécanique et pénible qu’ici. Impossible de déceler la moindre étincelle de sentiment ou d’émotion sous sa mise-en-plis peroxydée.
Tous les poncifs sont là : Lana est une aventurière plus ou moins nympho, qui passe d’amant en amant sous l’œil affligé de son pauvre Michael Rennie d’époux. Elle tombe amoureuse d’un jeune docteur hindou et cherche la rédemption au travers de cet amour sincère. Le spectateur peu friand de ce genre de niaiserie bénira – au bout d’une longue heure de projection – l’arrivée de la mousson promise dans le titre. En effet, de gros mélo dégoulinant, « LA MOUSSON » se transforme subitement et sans prévenir en film-catastrophe. Et le plus incroyable, c'est que les F/X sont étonnamment efficaces pour l’époque, les scènes d’inondation parfaitement crédibles. On se réveille pendant quelques trop brèves minutes.

Pas de quoi s’infliger la chose jusqu'au bout, néanmoins. On pourra éventuellement rester pour Richard Burton enduit de fond-de-teint et enturbanné dans ce rôle de docteur au cœur pur. Quelle étrange carrière que celle de ce gigantesque acteur qui a tourné tant de nanars ! À ses côtés, le toujours fiable Fred MacMurray assure dans un rôle de cynique alcoolique.
À voir en connaissance de cause donc, pour les amateurs de mélodrame exotique et de CinémaScope balbutiant.
8 décembre 2012
6
08
/12
/décembre
/2012
08:31
D'accord, on a compris : on ne reverra certainement jamais de chef-d’œuvre signé Woody Allen. Et pour se souvenir des raisons pour lesquelles on l’aime tant, il faut revenir à ses anciens films. Aussi, c'est sans illusion qu’on se plonge dans sa livraison touristique annuelle, « TO ROME WITH LOVE ».
Que dire ? C'est plutôt meilleur que les précédents et tout particulièrement que l’affreux « MIDNIGHT IN PARIS ». Meilleur parce qu'il apparaît dedans dans son rôle habituel et que c'est toujours sympathique de le retrouver, parce que la photo de Darius Khondji met bien la Ville Éternelle en valeur et parce que quelques idées comme ce chanteur d’opéra qui n’est génial que sous la douche ou la satire de la télé-réalité, sont plutôt bien vues.
toujours sympathique de le retrouver, parce que la photo de Darius Khondji met bien la Ville Éternelle en valeur et parce que quelques idées comme ce chanteur d’opéra qui n’est génial que sous la douche ou la satire de la télé-réalité, sont plutôt bien vues.
Mais que de radotage ! Combien de fois a-t-on déjà vu cette « kamikaze » incarnée par Ellen Page qui reprend le flambeau de Charlotte Rampling, Winona Ryder ou Juliette Lewis ? Pourquoi doit-on subir dix fois la même situation avec Roberto Begnini, alors que l’idée tourne court aussi vite ? Comment justifier que le sketch de la jeune prof cédant aux avances du cabotin ventripotent, tourne ainsi au vulgaire vaudeville ?
« TO ROME WITH LOVE » fait s’entrecroiser plusieurs historiettes vaguement désuètes, toutes basées sur le fantasme et les dangers qu'il y a à le réaliser, sur les bienfaits de la transgression tant qu'elle ne reste qu’à l’état de projet. Ça patine beaucoup, ça bégaie même parfois et la durée – presque deux heures, tout de même – fait regretter le temps où les films de Woody atteignaient à peine les 80 minutes.
On peut se consoler avec la beauté fulgurante de Penélope Cruz amusante en call-girl délurée, avec le plaisir fugace de revoir Judy Davis dans un rôle d’épouse sans intérêt et de constater qu’Alec Baldwin a retrouvé la ligne. C'est peu, mais si on n’est pas trop exigeant, on peut s’en contenter. Heureusement, comme toujours, le choix de chansons anciennes de la BO est un vrai plaisir !
19 novembre 2012
1
19
/11
/novembre
/2012
09:34
 Hemingway, Zanuck, Ava Gardner, Errol Flynn… Autant de noms alignés au même générique qui ne peuvent qu’aimanter le cinéphile curieux. De fait, « LE SOLEIL SE LÈVE
Hemingway, Zanuck, Ava Gardner, Errol Flynn… Autant de noms alignés au même générique qui ne peuvent qu’aimanter le cinéphile curieux. De fait, « LE SOLEIL SE LÈVE  AUSSI » se présente sous les meilleurs augures : budget important, CinémaScope, tournage en extérieurs, que des promesses de dépaysement et de romanesque.
AUSSI » se présente sous les meilleurs augures : budget important, CinémaScope, tournage en extérieurs, que des promesses de dépaysement et de romanesque.
Hélas, il faut vite déchanter. Car passé au crible hollywoodien, le roman de « Papa » n’est plus qu’un circuit touristique organisé en Espagne, pendant la feria de Pampelune, où l’on suit passivement et pendant deux longues heures, la dérive d’un groupe d’oisifs américains, une bande de pochtrons plus ou moins lamentables, agglutinés autour d’une belle femme elle-même sérieusement portée sur la bouteille. On devine que le fond de l’histoire est l’impossible amour entre cette aventurière fantasque et le journaliste revenu « diminué » de la WW1, mais les thèmes ont vraiment du mal à faire surface au milieu de ce semi-reportage bigarré et bruyant. On assiste à quelques corridas « light », à des bagarres d’ivrognes, des lendemains de cuite et on se perd dans les ruelles en folie, jusqu'à l’endormissement complet.
Le cast si attractif est terriblement décevant : Gardner si belle, n’a rien à jouer, ou plutôt semble constamment rejouer la même scène. Tyrone Power n’a aucun charisme, aucun humour et a tout du raseur, mais le plus triste est encore Flynn, empâté, vieilli avant l’âge, pathétique dans ce personnage de vieux lord ruiné et ivre-mort du matin au soir. Difficile de savoir où s'arrête la réalité et où commence la composition. À noter la brève présence de Juliette Greco dans quasiment son propre rôle transposé dans les années 20 et de Dalio, jouant un restaurateur servile appelé ‘Zizi’ (sic !). Sans oublier le futur producteur Robert Evans, qui offre une des pires prestations de l’Histoire du Cinéma en matador espagnol. Éclats de rire assurés.
humour et a tout du raseur, mais le plus triste est encore Flynn, empâté, vieilli avant l’âge, pathétique dans ce personnage de vieux lord ruiné et ivre-mort du matin au soir. Difficile de savoir où s'arrête la réalité et où commence la composition. À noter la brève présence de Juliette Greco dans quasiment son propre rôle transposé dans les années 20 et de Dalio, jouant un restaurateur servile appelé ‘Zizi’ (sic !). Sans oublier le futur producteur Robert Evans, qui offre une des pires prestations de l’Histoire du Cinéma en matador espagnol. Éclats de rire assurés.
Bref, on peut voir ce pudding bourratif pour des vues d’un Paris à peine reconnaissable, pour des courses de taureaux (si on aime les courses de taureaux) et pour la divine Ava qui paraît s’ennuyer autant que nous. On peut aussi ne PAS le voir !
 et enfin Liam Neeson tout jeune et fougueux.
et enfin Liam Neeson tout jeune et fougueux. 



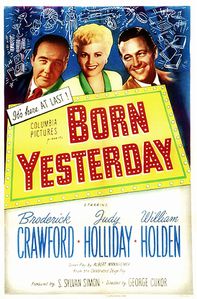 y est – de fascisme.
y est – de fascisme.
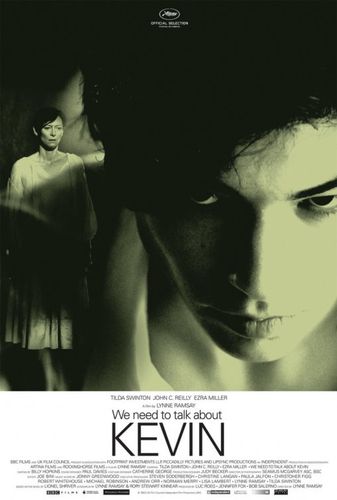 mère pour son propre enfant.
mère pour son propre enfant. TRIP
TRIP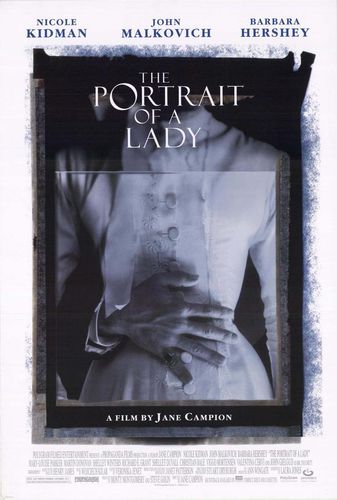 Cinéaste fétiche du festival de Cannes, Jane Campion – hormis le très beau «
Cinéaste fétiche du festival de Cannes, Jane Campion – hormis le très beau « 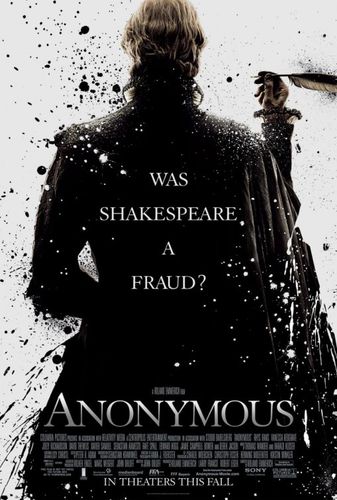 signature du belliqueux Roland Emmerich à la mise en scène.
signature du belliqueux Roland Emmerich à la mise en scène. Certains sujets sont vraiment dans l’air du temps et ce n’est certainement pas par hasard que «
Certains sujets sont vraiment dans l’air du temps et ce n’est certainement pas par hasard que «  obsédés par les grosses vagues et les bitures. Mais la comparaison avec le Cimino s'arrête là. «
obsédés par les grosses vagues et les bitures. Mais la comparaison avec le Cimino s'arrête là. «  Lana Turner était considérée comme la reine du ‘tearjerker’ (les films qui font pleurer) et malgré un talent de comédienne très limité, elle a fait une jolie carrière dans cet emploi.
Lana Turner était considérée comme la reine du ‘tearjerker’ (les films qui font pleurer) et malgré un talent de comédienne très limité, elle a fait une jolie carrière dans cet emploi.  «
« 
 toujours sympathique de le retrouver, parce que la photo de Darius Khondji met bien la Ville Éternelle en valeur et parce que quelques idées comme ce chanteur d’opéra qui n’est génial que sous la douche ou la satire de la télé-réalité, sont plutôt bien vues.
toujours sympathique de le retrouver, parce que la photo de Darius Khondji met bien la Ville Éternelle en valeur et parce que quelques idées comme ce chanteur d’opéra qui n’est génial que sous la douche ou la satire de la télé-réalité, sont plutôt bien vues. Hemingway, Zanuck,
Hemingway, Zanuck, 
 humour et a tout du raseur, mais le plus triste est encore Flynn, empâté, vieilli avant l’âge, pathétique dans ce personnage de vieux lord ruiné et ivre-mort du matin au soir. Difficile de savoir où s'arrête la réalité et où commence la composition. À noter la brève présence de Juliette Greco dans quasiment son propre rôle transposé dans les années 20 et de Dalio, jouant un restaurateur servile appelé ‘Zizi’ (sic !). Sans oublier le futur producteur Robert Evans, qui offre une des pires prestations de l’Histoire du Cinéma en matador espagnol. Éclats de rire assurés.
humour et a tout du raseur, mais le plus triste est encore Flynn, empâté, vieilli avant l’âge, pathétique dans ce personnage de vieux lord ruiné et ivre-mort du matin au soir. Difficile de savoir où s'arrête la réalité et où commence la composition. À noter la brève présence de Juliette Greco dans quasiment son propre rôle transposé dans les années 20 et de Dalio, jouant un restaurateur servile appelé ‘Zizi’ (sic !). Sans oublier le futur producteur Robert Evans, qui offre une des pires prestations de l’Histoire du Cinéma en matador espagnol. Éclats de rire assurés.